Émergence d’une ataxie cérébelleuse chez le Staffordshire terrier américain
Dr S. Blot, DVM, PhD, Diplom. ECVN
Dr JL. Thibaud, résidant
Unité médico-chirurgicale de Neurologie
Département d’élevage et de pathologie des Carnivores
Domestiques et des Équidés
École National Vétérinaire d’Alfort
7, avenue du Général de Gaulle
94704 Maisons-Alfort cedex
Téléphone : 01 43 96 71 71
Fax : 01 43 96 70 89
Secrétariat du service : 01 43 96 71 66
Email : sblot@vet-alfort.fr
A la consultation de Neurologie de l’École Nationale Vétérinaire
d’Alfort, nous assistons depuis un an à la recrudescence
de cas d’ataxie cérébelleuse chez le Staffordshire
terrier américain. Cette recrudescence reflète une dissémination
importante de la maladie au sein de l’élevage français.
Cette forte prévalence nécessite la mise au point d’un
diagnostic précoce. Les études préliminaires ont
permis de définir le cadre nosologique de cette affection. Il nous
semblait maintenant important de vous informer de l’émergence
de cette nouvelle entité pathologique et de vous demander votre
participation afin de satisfaire au plus vite l’objectif suivant
: prévenir la dissémination de la maladie dans l’ensemble
de l’élevage français.
Une ataxie cérébelleuse progressive de l’adulte…
La maladie concerne autant les mâles que les femelles et se retrouve
chez des chiens provenant de toute la France. Elle est également
rencontrée chez des chiens provenant des États-unis et d’autres
pays européens. L’ataxie se déclare chez des animaux
adultes, âgés de 2,5 à 6 ans, elle s’aggrave
très lentement et amène une invalidité très
prononcée après plusieurs années.
En début d’évolution, le chien présente une
ataxie très discrète qui se manifeste essentiellement dans
des situations difficiles : virages et mouvements brusques, montées
ou descentes des escaliers.
Au cours du temps, les symptômes deviennent constants et la maladresse
se transforme en une hypermétrie de plus en plus prononcée.
Dans les situations difficiles, l’animal présente une aggravation
aiguë et transitoire de son ataxie : il s’aplatit sur le sol
avec la tête plus ou moins rejetée en arrière et le
regard dans le vide. Un nystagmus vertical est présent lors de
ces «crises». Ce nystagmus peut être mis en évidence
précocement dans l’évolution de la maladie en mettant
la tête du chien en hyperextension pendant quelques secondes. Cette
position aggrave transitoirement les symptômes neurologiques. Aucun
déficit de la proprioception consciente n’est noté.
Des tremblements, de la tête en particuliers (au repos comme à
l’action), une tête penchée d’un côté
ou de l’autre et une augmentation du polygone de sustention sont
également remarqués.
En fin d’évolution de la maladie, une diminution du clignement
à la menace peut être constatée. Les symptômes
n’évoluent jamais vers une modification du comportement.
L’ensemble des signes cliniques évoque une lésion
cérébelleuse.

Ataxie prononcée sur un chien de 6 ans
(début des signes vers l’âge de 4 ans)
…confirmée par l’I.R.M et l’analyse
histologique…
Les moyens diagnostiques à notre disposition sont restreints :
seule l’imagerie par résonance magnétique nucléaire
révèle une diminution de la taille du cervelet. Elle s’accompagne
d’une augmentation de la taille des sillons cérébelleux
et d’une accumulation de liquide cérébrospinal plus
importante autour du cervelet. Ces signes se majorent avec l’évolution
de la maladie. La ponction de liquide cérébrospinal met
en évidence une protéinorrachie discrètement augmentée
non spécifique. Le scanner ne permet pas de visualiser correctement
le cervelet. Les signes cliniques et les résultats des examens
complémentaires permettent de conclure à une atrophie cérébelleuse.
L’examen histologique montre une lésion uniquement localisée
au cervelet se caractérisant essentiellement par une dépopulation
des cellules de Purkinje.
Analyse histologique du cervelet
|
Chien sain (laboratoire Anatomie Pathologie / ENVA) |
Chien malade (3 ans) |
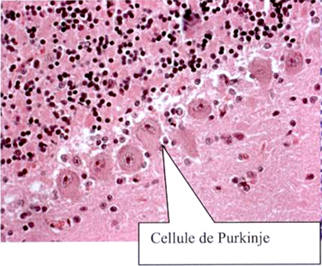 |
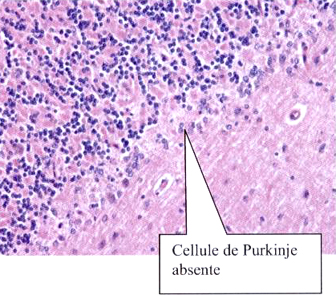 |
…se transmettant selon un mode autosomique
récessif.
Enfin l’étude du pedigree des animaux atteints suggère
fortement une transmission héréditaire selon un mode autosomique
récessif
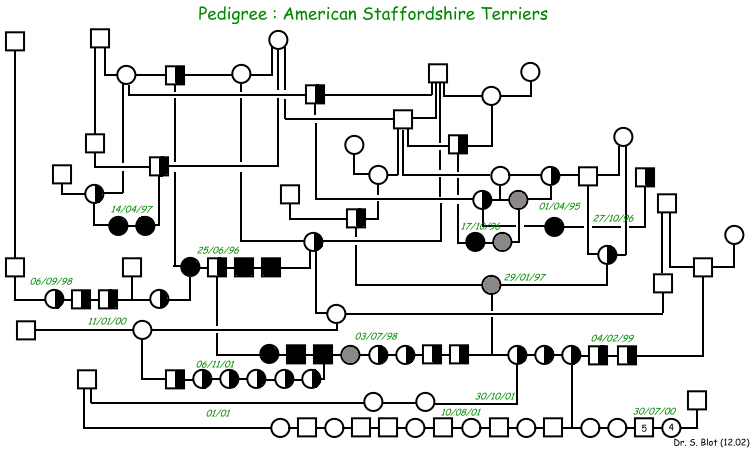
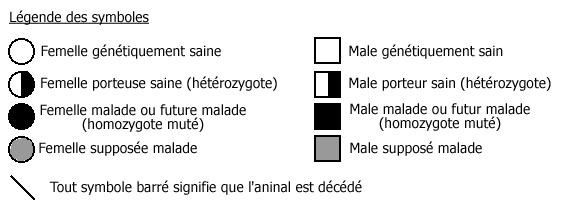
Ainsi, cette affection héréditaire menace
le Staffordshire terrier américain pour plusieurs raisons :
- le caractère tardif de l’apparition de la maladie fait
que le diagnostic suit la réalisation de plusieurs portées
: il y a donc dissémination de la maladie,
- le mode de transmission autosomique récessif sous entend l’existence
de nombreux individus porteurs sains mais conducteurs (les hétérozygotes)
qui participent à la dissémination de la maladie.
Aussi est-il urgent de posséder un moyen de diagnostic et de dépistage
précoce et peu coûteux, tel un test génétique
qui permettrait non seulement d’établir un diagnostic sur
les animaux malades mais surtout le dépistage des animaux hétérozygotes
et homozygotes récessifs (futurs malades) dès la naissance.
L’élaboration de ce test est à notre portée.
La mise au point de ce test nécessite l’analyse préalable
de trente à cinquante échantillons de sang de chiens apparentés
malades ou non malades (conducteurs ou génétiquement sains).
Pour mener efficacement cette étude, nous sollicitons votre coopération
: nous sommes intéressés par des échantillons de
sang de chiens atteints de cette ataxie cérébelleuse ou
de chiens indemnes âgés de plus de sept ans avec pedigree.
GLOSSAIRE :
- ataxie : trouble de l’équilibre ou de
la coordination motrice
- hypermétrie : démarche caractérisée
par des foulées dont l’amplitude est exagérée
- nystagmus : déplacement des yeux «à
ressort» comportant une phase rapide et une phase lente, ici le
déplacement est excessif, non coordonné au déplacement
de la tête, donc pathologique
- cervelet : partie de l’encéphale (le système
nerveux inclus dans la boîte crânienne)
- porteur sain ou animal conducteur : animal ne présentant
pas les signes cliniques de la maladie mais porteur sur l’un des
chromosomes d’un même paire d’un gène anormal.
Il est capable de transmettre à ses descendants la tare correspondante.
Il est dit hétérozygote car les deux formes du même
gène ne sont pas homogènes. Un individu sain sur le plan
génétique est homozygote sauvage, le caractère sauvage
étant considéré comme le caractère normal,
les deux formes de ce caractère sont alors les mêmes.
La complexité du dépistage de la maladie est due au caractère
récessif de la maladie. Car le statut clinique ne reflète
pas le statut génétique. Plusieurs situations cliniques
et génétiques sont rencontrées, et particulièrement
pour les maladies récessives, une même présentation
clinique peut révéler plusieurs statuts génétiques
(voir tableau suivant).
TYPE D'ANIMAL |
STATUT CLINIQUE (=phénotype) |
STATUT GENETIQUE (=genotype) |
| Sain génétiquement |
Sain toute sa vie |
Indemne, non conducteur, homozygote sauvage, ne transmet
pas la maladie à sa descendance sauf s’il est croisé
avec un malade ou un hétérozygote |
| Conducteur |
Sain toute sa vie |
Hétérozygote, transmet l’anomalie
génétiquement à sa descendance même s’il
est croisé avec un individu génétiquement sain.
|
Chien jeune (< 2 ans) qui va devenir malade |
Sain jusqu’à l’apparition des symptômes |
Homozygote muté, les 2 formes du même
caractère sont anormales, quelque soit le chien avec lequel
il est croisé (même avant l’apparition des signes
cliniques), il transmet à sa descendance l’anomalie
génétique. |
|
Chien malade (animal > 2 ans) |
Malade, signes s’aggravant progressivement |
Homozygote muté, les 2 formes du même caractère sont anormales, quelque soit le chien avec lequel il est croisé (même avant l’apparition des signes cliniques), il transmet à sa descendance l’anomalie génétique. |
4 situations cliniques |
2 phénotypes |
3 génotypes |
Exemples de croisements et résultantes
1. Si les deux parents sont génétiquement sains...
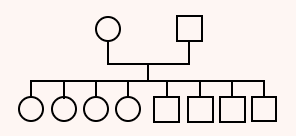
...ont des descendants génétiquement sains, non conducteurs...
2. Si l’un des parents est malade...
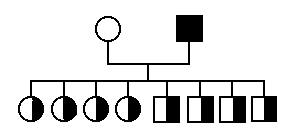
... TOUS les descendants, à la première génération
sont non malades, mais porteurs...
3. Si l’un des parents est porteur...
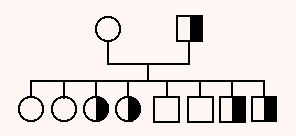
... 50% des descendants, à la première génération,
sont porteurs, les 50% restant sont génétiquement sains...
4. Si les deux parents sont porteurs...
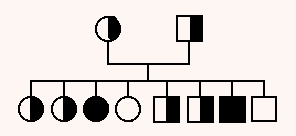
... 50% sont porteurs sains (moitié de mâles, moitié
de femelles), 25% sont malades, 25% sont génétiquement sains...
5. Si les deux parents sont malades...
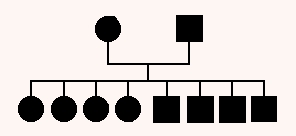
... TOUS LES DESCENDANTS SONT MALADES...
Soit avec la simulation suivante :
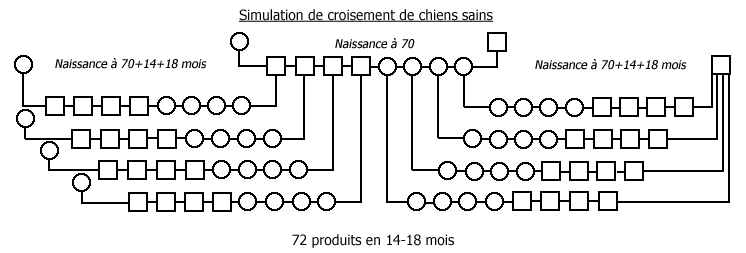
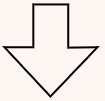
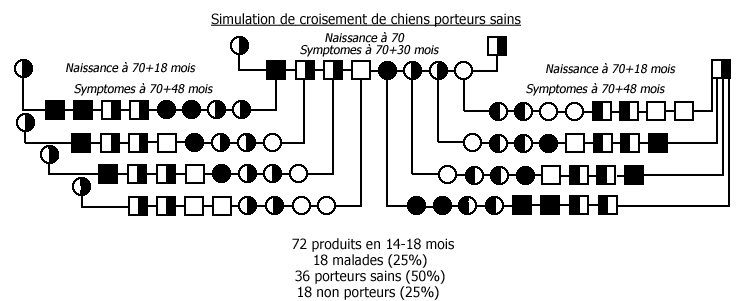
Pedigrees à rechercher
1. Exemple de pedigree type :
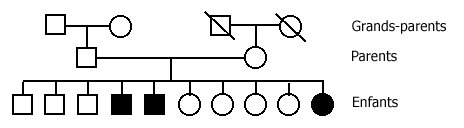
2. Pedigree idéal :
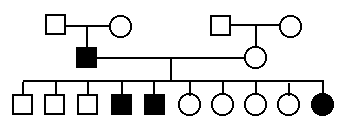
3. Pedigree très intéressant :
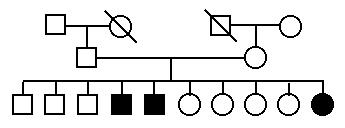
4. Pedigree utile :
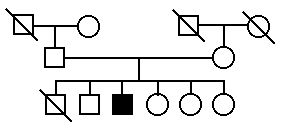
Nous vous rapellons que les documents présentés ici sont la propriété de leur(s) auteur(s) dans leur intégralité (textes, photos, graphismes...), et qu'ils ne peuvent être copiés, totalement ou partiellement, sans l'accord de ce(s) dernier(s).